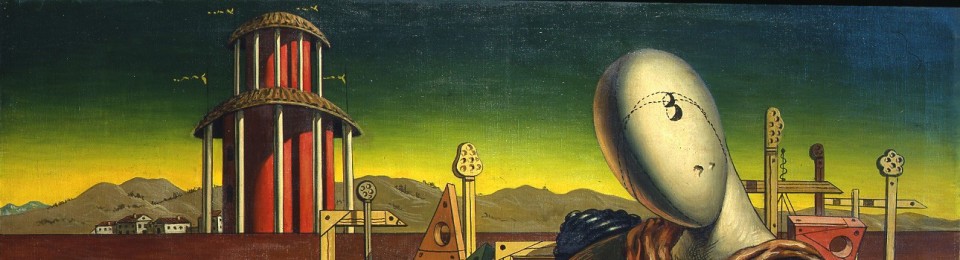Étiquettes
culture, objectivité et subjectivité, relativisme culturel, Roy Wagner
« Comme l’épistémologue qui s’intéresse à «la signification de la signification», ou comme le psychologue qui pense la façon dont on pense, l’anthropologue est contraint de s’inclure, lui et son mode de vie, dans son objet et de s’étudier lui-même. Plus exactement, puisque nous désignons par «culture» l’ensemble des compétences d’une personne, l’anthropologue se sert de sa culture pour étudier à la fois les autres cultures et la culture en général. Ainsi, la prise de conscience de la culture oblige à moduler la visée de l’anthropologue et son point de vue, en tant que scientifique : il doit renoncer à la prétention d’objectivité absolue du rationalisme classique, en faveur d’une objectivité relative fondée sur les caractéristiques de sa propre culture. Il est bien sûr nécessaire que le chercheur soit aussi neutre que possible en étant conscient de ses présupposés, mais nous prenons souvent les présupposés les plus fondamentaux de notre culture pour des évidences qui vont tellement de soi que nous n’en sommes même pas conscients. Pour atteindre à une objectivité relative, l’anthropologue doit découvrir ce que sont ces présupposés, de quelle façon une culture permet de comprendre l’autre et les limites qu’elle impose à cette compréhension. Quant à l’objectivité absolue, elle nécessiterait que l’anthropologue n’ait aucun présupposé, et donc pas de culture du tout.
En d’autres termes, l’idée de culture place le chercheur sur un pied d’égalité avec ses objets d’étude : chacun « appartient à une culture ». Parce que toute culture peut être comprise comme une manifestation spécifique, ou un exemple, du phénomène humain et, d’autre part, que l’on n’a jamais trouvé de méthode infaillible pour «noter» des cultures différentes et les classer par types naturels, nous présupposons que toute culture, en tant que telle, est équivalente à toute autre. Ce présupposé est ce que l’on nomme «relativisme culturel».
La combinaison de ces deux corollaires de l’idée de culture, à savoir d’un part que nous appartenons nous-mêmes à une culture (objectivité relative) et d’autre part que nous devons présupposer que toutes les cultures sont équivalentes (relativisme culturel), cette combinaison, donc, conduit à une proposition générale quant à l’étude de la culture. Comme le suggère la répétition de la racine «relatif», comprendre une autre culture implique de mettre « en relation» deux variétés du phénomène humain. Il s’agit de créer entre elles une relation intellectuelle, une compréhension qui les englobe toutes deux. L’idée de «relation» est ici importante car elle est plus appropriée au rapprochement de deux entités ou de deux points de vue équivalents, que des notions comme «analyse» ou «examen », avec leur prétention à l’objectivité absolue.
Essayons d’examiner de plus près comment cette relation est mise en œuvre. L’anthropologue fait, d’une manière ou d’une autre, l’expérience de son objet d’étude à travers son propre univers de sens, puis il utilise cette expérience signifiante pour en communiquer la compréhension à ceux qui partagent sa culture. Il ne peut communiquer cette compréhension que si elle fait sens dans son univers culturel. Inversement, si ses théories ou ses découvertes relèvent d’un fantastique débridé, comme c’est le cas de maintes anecdotes d’Hérodote ou des récits des voyageurs médiévaux, on ne peut guère parler d’une vraie mise en relation des cultures. Une «anthropologie» qui ne sortirait jamais des frontières de ses propres conventions, qui dédaignerait d’investir son imagination dans le monde de l’expérience, resterait plus une idéologie qu’une science. »
Roy Wagner, L’invention de la culture, p. 20-21