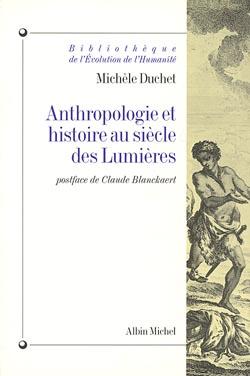On connaît l’incipit du 18 Brumaire Louis Napoléon Bonaparte :
« Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, la Montagne de 1848 à 1851 pour la Montagne de 1793 à 1795, le neveu pour l’oncle. Et nous constatons la même caricature dans les circonstances où parut la deuxième édition du 18 Brumaire.
Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté. C’est ainsi que Luther prit le masque de l’apôtre Paul, que la Révolution de 1789 à 1814 se drapa successivement dans le costume de la République romaine, puis dans celui de l’Empire romain, et que la révolution de 1848 ne sut rien faire de mieux que de parodier tantôt 1789, tantôt la tradition révolutionnaire de 1793 à 1795. C’est ainsi que le débutant qui apprend une nouvelle langue la retraduit toujours en pensée dans sa langue maternelle, mais il ne réussit à s’assimiler l’esprit de cette nouvelle langue et à s’en servir librement que lorsqu’il arrive à la manier sans se rappeler sa langue maternelle, et qu’il parvient même à oublier complètement cette dernière. »
Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis Napoléon Bonaparte
Même s’il n’y fait pas explicitement référence, il est difficile de croire que Bronislaw Baczko n’a pas en tête ce texte fameux, lorsqu’il évoque la théâtralisation des événements du 9 Thermidor ainsi que la part de farce dans la tragédie.
« Ne quittons pas encore cette journée exaltée par les uns comme un soulèvement héroïque contre le « tyran », dénoncée par les autres comme un moment tragique où le ressort même de la Révolution aurait été brisé. On sait bien que la Révolution manifeste tout à son long une forte tendance à théâtraliser ses faits et ses gestes, à s’offrir comme un spectacle contraignant, imposant à ses acteurs des rôles et des costumes. Le 9 Thermidor ne fait, sur ce plan non plus, pas exception et les récits de cette journée s’en sont souvent inspirés. Il faudrait pourtant préciser chaque fois la théâtralité de cette mise en représentation. On se souvient des épisodes, maintes fois contés, qui en font un drame, voire une tragédie à l’antique : les députés qui se lèvent en criant A bas le tyran ! ; ces mêmes conventionnels, menacés par les canons, qui décident de rester dans la salle et de mourir pour la République, à l’instar des sénateurs romains ; Robespierre, à la Commune, hésitant à se réclamer du peuple contre la Convention, qui est le pouvoir légitime de la République ; la salle du Comité de salut public où Robespierre, blessé, est étendu sur une table, où Saint-Just, impassible, fixe de ses yeux la Constitution, affichée sur le mur, et prononce les paroles : « Voilà pourtant mon ouvrage, et le gouvernement révolutionnaire aussi. » Images d’Epinal, dira-t-on, dont plusieurs ne résistent pas à la critique historique. Nul n’en doutera mais ces clichés sont entrés dans la mémoire historique pour laquelle les représentations engendrées par un événement sont souvent plus importantes que l’événement lui-même. Mais que l’imagerie ne masque pas le mélange de genres : le tragique tourne sans cesse au grotesque. Tallien agite à la tribune de la Convention un poignard dont il n’a guère l’intention de faire usage ni contre Robespierre ni contre lui-même ; Hanriot, chef de la force armée parisienne, tour à tour garrotté par quelques gendarmes et libéré par ses fidèles ; quelques centaines de Jacobins qui ne se lassent pas d’acclamer Robespierre et de lancer des appels héroïques à combattre les « scélérats » mais dont le nombre ne cesse de fondre, que dix ( !) personnes suffisent à disperser et dont la salle, « le bastion invincible de la Révolution » est, tout bêtement, fermée à clé, comme pour marquer la fin du spectacle. Des milliers d’hommes armés, groupés dans leurs bataillons, semblent se livrer à un étrange ballet : les mêmes qui, l’après-midi, sont partis pour soutenir la Commune se retrouvent, le soir, du côté de la Convention. Les canonniers se livrent à un aller-retour, entre place de Grève et place du Carrousel, sans avoir tiré un seul coup de canon. Comme pour ajouter à ce côté grotesque, le personnage à qui il incombe de jouer cette nuit-là le rôle particulièrement dramatique, le gendarme qui tira sur Robespierre, s’appelait Merda. Et cela sentait tellement le ridicule qu’on le rebaptisa vite en Meddat avant de le présenter à la Convention qui l’accueillit triomphalement. Cette nuit où les passions se déchaînèrent, où on ne jura, des deux côtés, que de « vivre libre ou mourir », on n’entendit tirer que deux coups de pistolet : celui du « brave gendarme » Merda et celui de Lebas, qui se suicida. La vraie tuerie ne commença que le lendemain de la victoire, place de la Révolution : vingt-deux guillotinés le 10 thermidor, soixante-six exécutés le 11 thermidor, la plus grande « fournée » qu’avait jamais connue Paris depuis l’avènement de la Terreur. Nous ne saurons jamais quel aurait été le nombre d’exécutés si le parti adverse, Robespierre et ses partisans, l’avait emporté… »
Bronislaw Baczko, Sortir de la Terreur –Thermidor et la révolution